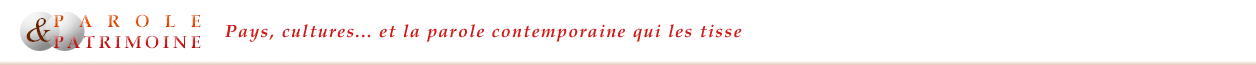Quelques dizaines de kilomètres depuis Paksé, la grande ville du sud Laos. On longe longtemps le Mékong, le fleuve vital, l’artère vivifiante de cette région de l’Asie.
Dans la voiture, le guide francophone qu’on a parfois du mal à comprendre, qui se répète un peu, est si gentil qu’on lui pardonne tout. On a suivi le livre, qui décrit cet ensemble de temples khmers bâtis aux XIe et XIIe siècles, sur un site déjà occupé depuis le Ve siècle, maintenant distingué par l’UNESCO sur sa liste mondiale.
On a suivi les conseils, pour scruter la mémoire, sans trop savoir, pour tenter d’approcher le brassage des peuples et les traces qu’ils ont laissées. On suit le gentil guide francophone, dans cette chaleur du matin, qui vous enveloppe et vous isole déjà, sans vous oppresser encore. On est toujours dans la plaine du fleuve, on voit les petites montagnes au loin, on marche. Et c’est bientôt une grande allée jalonnée de hautes bornes de pierres : comme souvent dans les sites imbibés de l’histoire et du génie des hommes, il faut d’abord se défaire de soi, de la première image glanée au hasard, on marche c’est pour apprendre la rumeur des hommes d’ici, celle qui a traversé les siècles, qui affleure, là, dans les pierres, et qu’on cherche à tâtons, sans la comprendre vraiment.

Voici le temple des hommes, puis celui des femmes, et toutes ces pierres numérotées qui jonchent le sol ici et là, en attente d’une restauration improbable. Les linteaux et les parois sont saturés de reliefs sculptés, qu’on peine à décrire, mais qui nous touchent d’une émotion brute, puissante, qui allège le corps et le rend dense en même temps. Je vois les nagas, les serpents mythiques, je pense aux pierres romanes de chez nous, je voudrais mieux éprouver ces correspondances.

Ce lieu fut sans doute d’abord animiste, puis hindouiste, puis bouddhiste. C’est ici le Laos des mélanges, où l’identité fuit le regard. Mais l’ampleur du lieu fait oublier toutes les catégories, ce lieu c’est l’univers, l’alliance des terres basses et du haut du ciel. On monte, on monte longtemps, il y a de petits autels décorés le long des marches. On ne sait pas vraiment vers quoi l’on monte, à travers ces immenses frangipaniers dont les fleurs splendides couronnent un squelette de branches et de ramures.

Tout en haut, on voit la source sacrée qui sort de la roche, ce qui a rendu jadis peut-être ce lieu propice aux rituels. Tout en haut, c’est le pays entier sous l’œil, le grand fleuve perdu dans la brume, les bassins d’eau plus près, les parcelles de terre grillée et leurs arbres encore verts. Tout en haut, on comprend soudain le bonheur d’être au monde, dans une sorte de naïveté première, quand on s’est enfin débarrassé de soi, de ses idées, de ce qui nous guide, quand le corps se mêle vraiment au paysage, au courant d’air qui court au long de la montagne, près de la source.
En 2018
Écriture le 23/01/25