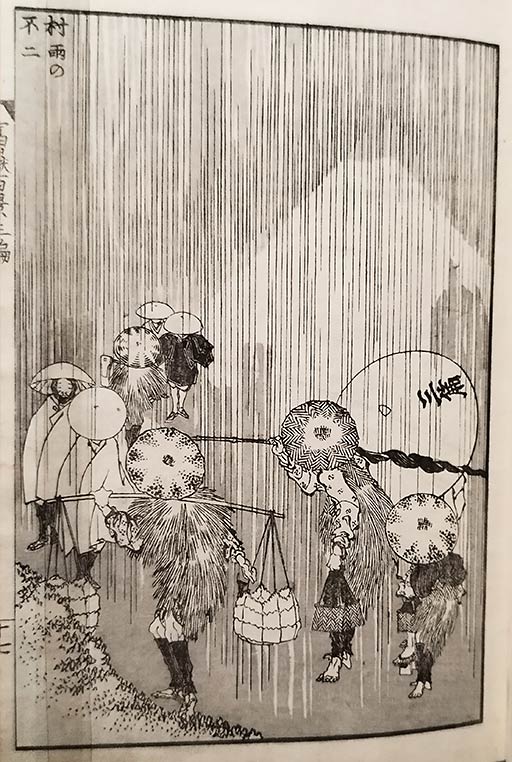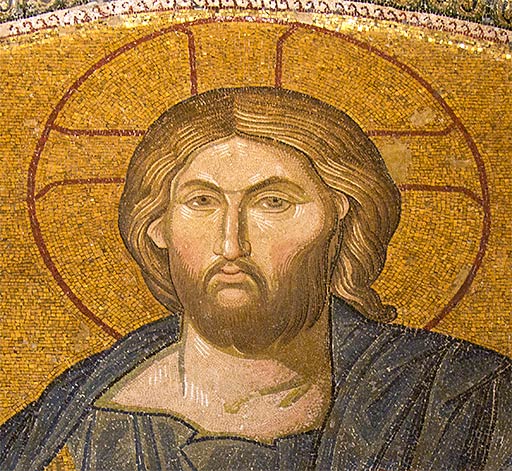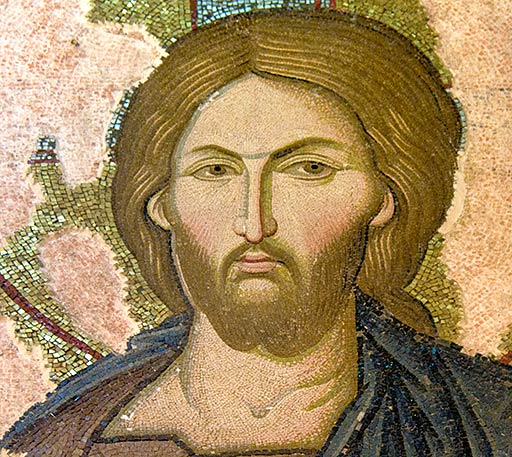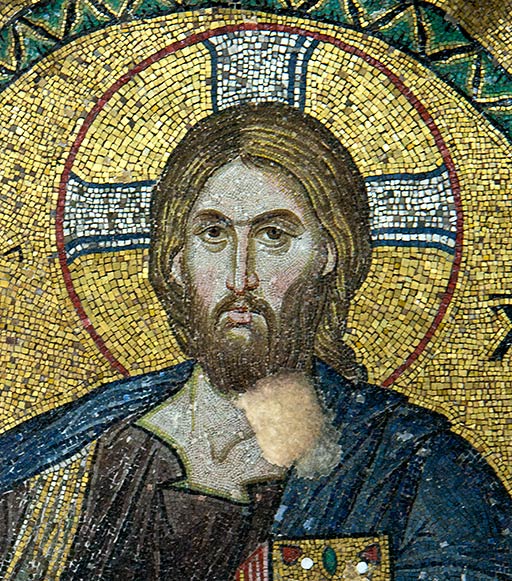C’est un livre qui tient du roman, du récit, de l’enquête, un livre intime et pourtant au cœur du monde, un livre peut-être comme une trace fulgurante à ce moment de notre aventure humaine, et dont on se demande s’il peut être reçu, comme on dit, accepté quelque peu, tant il est à sa manière iconoclaste.
Et tant le sujet dont il traite à vif – la vie éternelle – peut faire naître des ricanements ou du mépris au sein de notre ambiance rationaliste.
L’auteur, Javier Cercas1, se dit d’entrée de jeu "athée","anticlérical", "laïc militant, rationaliste obstiné, impie rigoureux". Et l’exergue du livre se poursuit ainsi :
Et pourtant je me trouve ici, dans un avion à destination de la Mongolie en compagnie du vieux vicaire du Christ sur la terre, m’apprêtant à l’interroger sur la résurrection de la chair et la vie éternelle. C’est pourquoi je suis monté dans cet avion : pour demander au pape François si ma mère verrait mon père après sa mort, et pour transmettre sa réponse à ma mère. → p. 11
Javier Cercas a perdu sa foi d’enfant à l’adolescence, puis a cherché dans l’écriture littéraire cette part manquante, qui finalement n’a jamais en lui été comblée. Il a lu Nietzsche et son fou qui va proclamant la mort de Dieu – "nous l’avons tué" – et Dostoïevski : "Si Dieu n’existe pas, tout est permis". Plus d’un siècle après ces affirmations des penseurs européens, que reste-t-il de cette rupture de libération croyait-on, dans les affaires humaines ? La mère de l’auteur elle, âgée, malade, vit une foi profonde, pure, et dans cette croyance qu’après sa mort elle retrouvera son mari, son amour de toute une vie.
Au printemps 2023, lors d’un salon du livre à Turin, Javier Cercas est approché par un "homme du Vatican" : le pape François doit faire un voyage en Mongolie fin août, et on a pensé à lui pour écrire sur ce voyage, avec toute liberté de publication. Il se récrie ("auriez-vous perdu la tête ?"), mais on le rassure : "on savait que je n’étais pas croyant et que c’était précisément pour cette raison qu’on me proposait d’écrire ce livre".
À ce stade de la lecture, on peut craindre le pire, de la puissante machine ecclésiale broyant l’intrépide écrivain, et on aurait tort, tant les quelques centaines de pages qui suivent sont ébouriffantes et traversent, par les personnages du récit, nos interrogations d’aujourd’hui. Il serait vain de vouloir les décrire, ces pages, mais nous allons picorer dedans, pour tenter d’en saisir des images révélatrices.
L’auteur fait son travail d’enquêteur, il cherche des sources, et rencontre à Rome ceux qu’il nomme "les soldats de Bergoglio", qui travaillent dans les rouages de la gouvernance de l’Église. Extrait d’un échange avec le père Spadaro, jésuite proche de François :
Le problème, c’est que, chez nous, en Occident, la raison est détachée du sentiment. On les a opposés. Le problème, c’est que l’on considère que tout ce qui est sentiment, amour, foi, n’a rien à voir avec le raisonnement, qui n’est que calcul, méthode. Cette vision de la raison est très pauvre, abstraite, froide. Cette rationalité n’est pas la rationalité humaine : c’est une rationalité informatique. Le problème, par conséquent, c’est comment on définit la raison, et non si la raison participe ou pas de l’acte de foi. Les hommes raisonnent. Votre mère raisonne. Les gens de votre village raisonnent. La foi n’est pas un simple acte de sentiment. La raison est un facteur complexe de notre humanité : ce n’est pas simplement deux plus deux égale quatre.
— Le problème alors, c’est qu’on a séparé la foi et la raison.
— Oui. L’intuition poétique n’est pas irrationnelle : elle génère un résultat qui est aussi celui du raisonnement. La poésie comporte une rationalité d’un autre niveau, qui s’intègre au sentiment. Mais en effet : une fracture entre foi et raison s’est produite en Europe, et ce n’est pas un problème seulement pour la foi. Pour la vie en général aussi, c’en est un. → p. 102
Ou avec le cardinal poète Tolentino, un peu plus loin :
— Quand il [le pape François] est revenu du Japon, par exemple, les journalistes lui ont demandé : Après ce voyage, que croyez-vous que l’Occident peut apprendre de l’Orient ? Et vous savez ce qu’il a répondu ? Un peu de poésie.
— Ah, excellent !
— Et cela a à voir avec ce que vous dites. Parce que la poésie est la capacité de contemplation du visible et de l’invisible, de ce que l’on peut toucher et de ce qui demeure un mystère. → p. 130
Cercas rapporte ces entretiens en les situant comme des scènes de vie, où l’humour et l’ironie sont présents, mais où revient sans cesse la question qui le taraude. Un journaliste accrédité au Vatican lui répond ceci :
Comment croire à une autre vie si on ne la pressent pas dans celle-ci ? L’expérience d’une humanité inexplicable humainement est ce qui permet de la pressentir, d’avoir l’intuition qu’il y a quelque chose de plus et de meilleur que ceci. C’est le début de la vie éternelle : la vie éternelle commence ici même. → p. 187
Au passage de l’écriture se dessine la complexité du monde ecclésial romain, et la figure en ombre de François, sa manière à lui d’être fou de Dieu, comme son modèle d’Assise, de se vouloir en périphérie, hors des fastes, lui qui dit :
Dépeindre le pape comme une sorte de Superman m’offense. Le pape est un homme qui rit, pleure, dort tranquillement et a des amis comme tout le monde. Une personne normale. → p. 451-452
Et Javier Cercas, l’athée et le rationaliste obstiné, d’ajouter :
Ce qui est exceptionnel, ce n’est pas le pape : ce qui est exceptionnel, c’est l’Église catholique ; c’est-à-dire la promesse de l’Église catholique ; c’est-à-dire la promesse du Christ : l’annonce rayonnante de l’amour illimité, de la résurrection de la chair et la vie éternelle. Tous les pouvoirs, tous les souverains, tous les règnes et tous les empires sont tombés ; mais, après deux mille ans d’histoire, l’Église catholique tient toujours debout : cette promesse a prouvé qu’elle était indestructible, plus puissante que toutes les armées réunies. Si je croyais aux miracles, je croirais que ceci est un miracle. → p. 452
Dans l’avion vers la Mongolie, il s’entretient en tête à tête avec le pape et le filme. On ne saura qu’à la fin du livre ce qu’ils se disent, quand il montrera le film à sa mère affaiblie. La Mongolie, le bout du monde, un pays tiraillé entre la tradition des steppes et la capitale Oulan-Bator déjà bien occidentalisée, un pays où l’on ne compte que 1500 catholiques que le pape est venu rencontrer, comme une sorte de geste gratuit. "On ne peut pas être missionnaire sans être fou à lier." → p.253
Et c’est le paradoxe de la quête de Cercas : en vivant quelques instants de cette folie avec les religieux catholiques présents sur place, il s’approche de ce vécu radicalement différent qui le touche et qu’il décrit avec véhémence et humilité à la fois. Il transcrit par exemple les mots de cette jeune femme italienne, devenue religieuse après des études de philosophie à l’université de Turin et qu’on a envoyée ici il y a un an :
J’ai toujours senti que mon cœur avait de grandes dimensions… Aussi grandes que le monde… […] Il s’agissait de servir et d’aimer là où le besoin se faisait sentir, d’aider ceux qui en avaient besoin. C’était ça le sens de mon élan, me livrer… → p. 311-312
L’écriture de Cercas n’est pas celle d’un journaliste, mais d’un écrivain que ses échanges emportent au cœur de son intimité, de ce qui le questionne au plus profond. Au moment de quitter ces gens avec qui la fraternité a soudain pris sens, il écrit à propos du père Ernesto :
Je vois ce vieux missionnaire à l’âge de vingt-huit ou vingt-neuf ans, qui vient d’être ordonné prêtre, pédalant debout dans la pénombre matinale d’une forêt du Zaïre, ivre d’ardeur apostolique, prêt à sauver toux ceux qui se présentent devant lui, je le vois en train de lever le corps du Christ dans une case d’un village d’Afrique […] je le vois dire la messe dans la steppe enneigée, âgé d’une cinquantaine d’années, fraîchement arrivé en Mongolie avec ce fou de Marengo et ses premiers compagnons de la Consolata, comme des chrétiens poursuivis ou des révolutionnaires illuminés ou des sherpas de Dieu… → p. 352
On pourrait certes se demander à bon droit comment justifier cette folie de l’Occident chrétien d’aller "évangéliser toutes les nations", et par là même de briser les cultures de ces gens. Il n’y a sans doute pas de justification, sauf cette foi en la parole d’un homme d’il y a deux mille ans, qui annonce l’unité de l’humanité, l’amour radical et la vie éternelle. Et l’on sait bien aussi que cette parole s’est vue mélangée à bien d’autres soifs de conquêtes et de dominations intolérables. Et qu’aujourd’hui comme hier ce monde globalisé est en proie à la cruauté plus qu’à la paix.
À son retour de Mongolie, Javier Cercas s’en va voir sa mère, lui montrer son entretien avec le pape. Peut-il dire à sa mère qu’après sa mort, elle reverra son père ? "Sa réponse est fulgurante […] : sans le moindre doute" → p. 463-464. Dès lors, il écrit :
Hannah Arendt a-t-elle raison quand elle dit que les athées sont "des imbéciles qui prétendent savoir ce qu’aucun être humain ne peut savoir" ? Et si c’était François qui avait raison ? […] Et si Nietzsche se trompait et que le christianisme n’était pas une négation de la vie mais une rébellion contre la mort et c’est pourquoi la résurrection de la chair et la vie éternelle se trouvent en son centre – pareils à des morceaux de lave brûlants dans un cratère en activité -, parce qu’elles représentent l’affirmation de la vie au-delà de la vie, au-delà de la mort ? → p. 466
1 Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud, 2025. Né en 1962 en Espagne, dans une famille franquiste / catholique, il a enseigné dans des universités américaines, et publié une quinzaine d’ouvrages, traduits dans une trentaine de langues.
Écriture le 28/10/25