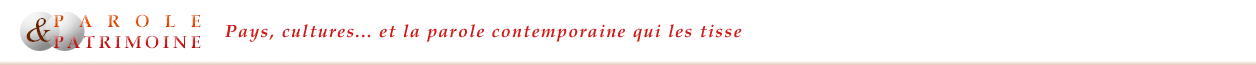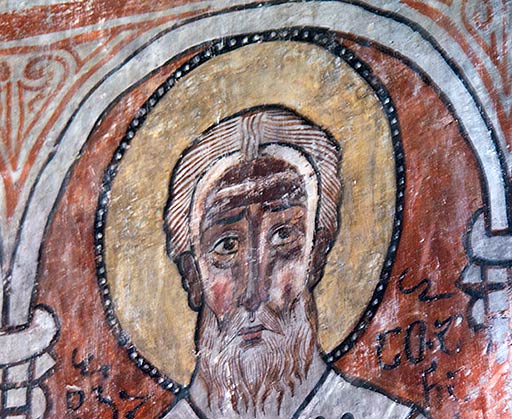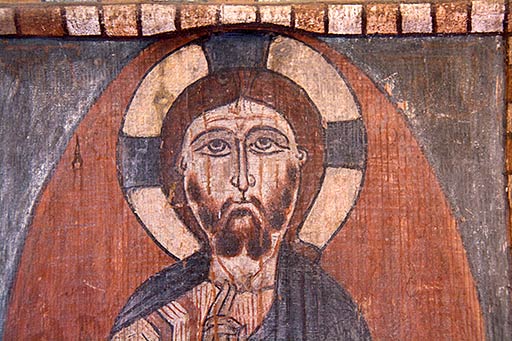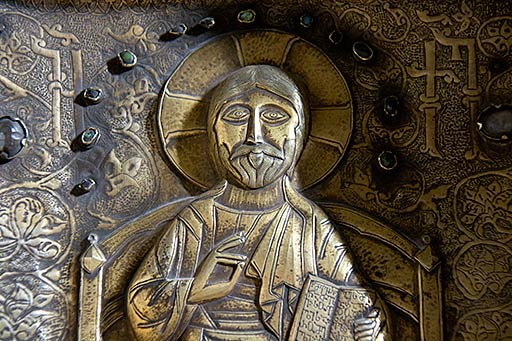Comment expliquer le déni de l’humanité face à des conclusions scientifiques alarmantes, alors que la science est au cœur de notre époque et son moteur évident ?
Continuons notre parcours initié dans l’article précédent, à partir de la parution en 1972 du rapport Meadows1, sur les limites de la croissance.
Tendances
On pourrait d’abord se dire que l’alarme formulée en 1972 n’était pas fondée, que le modèle et ses simulations étaient trop imparfaites et que, cinquante ans plus tard, l’évolution du monde n’est pas en cohérence avec ce que le rapport prévoyait.
Jean-Marc Jancovici, analyste infatigable, détaille et francise le travail de Graham Turner, chercheur australien qui a eu l’idée de comparer les résultats du rapport Meadows avec 30 ans de réalité, sur la période 1970-2000 :
Sans fournir la preuve absolue que l’effondrement « prédit » par l’équipe Meadows se réalisera au cours du 21è siècle, cette confrontation des simulations à ce qui s’est vraiment passé depuis la publication du travail de Meadows est à tout le moins troublante. Sur les aspects «énergie-climat», elle est même très troublante, parce que les hypothèses de Meadows et les caractéristiques des stocks de combustibles fossiles ou des émissions de gaz à effet de serre sont vraiment très proches2.
On doit ensuite admettre que la démocratie ne fait pas bon ménage avec les changements radicaux qu’il faudrait impulser. Interviewé en 2022 par Reporterre, Dennis Meadows illustre simplement ce fait :
Comment expliquez-vous que la croissance soit restée l’alpha et l’oméga des dirigeants de la planète, alors que vous avez montré dès 1972 qu’il s’agissait d’une impasse ?
Il est impossible de comprendre le débat sur les limites à la croissance sans réaliser à quel point celle-ci est bénéfique à court terme aux pouvoirs en place. Cela leur donne de la puissance politique et de la richesse financière. [...] Beaucoup de dirigeants ont lu les Limites à la croissance, et l’ont perçu comme juste. Mais ils n’ont pas pu en prendre acte. Un jour, l’un d’entre eux m’a dit : « Vous m’avez convaincu de ce que je dois faire. Maintenant, vous devez m’expliquer comment je peux être réélu si je le fais. »3
La cabane et sa triste impuissance
Lors d’une conférence, en réponse à une question sur l’enlisement du rapport Meadows, Jean-Marc Jancovici évoquait le fait que, face à une oeuvre-monde, il n’y avait pas d’interlocuteur-monde4. Autrement dit, pas de gouvernance mondiale, seulement une cacophonie hétéroclite des nations.
Du moins aurait-on pu penser que, devant l’évidence scientifique des analyses qui depuis cinquante ans se sont renforcées, avec notamment les rapports du GIEC, les citoyens se lèvent et finissent par imposer aux gouvernants une inflexion significative. Ce n’est pas vraiment ce à quoi on assiste.
Abel Quentin, dans un copieux roman récent intitulé Cabane5, prend comme source ce qu’il nomme le rapport 21 :
Le contenu du rapport 21 est librement inspiré du rapport Les Limites à la croissance, de 1972. Quant aux auteurs du rapport 21, ils ont été inventés de toutes pièces, pour les besoins de la cause. → [CA] p. 9, Note au lecteur.
La littérature donne parfois à entendre et voir le monde mieux que la réflexion. Plus précisément la création littéraire accouche en quelque sorte d’un réel plus dense que la vraie vie, et donc plus révélateur. Sur la couverture du livre est reproduite une peinture d’Edward Hopper, de 1960, People in the Sun, où quelques personnages se reposent face au soleil, sur des transats, sans rien faire, sauf un, plus en retrait, qui lit un livre. Lire, à la suite d’écrire, rien qui puisse changer le monde…
La première partie du livre s’intitule Le Rapport. La scène ne se passe pas au M.I.T. mais à Berkeley, foyer de la contre-culture, sur la côte Ouest. Les quatre auteurs sont Eugene et Mildred Dundee, dont on devine les échos avec le couple Meadows, Paul Quérillot un français, et Johannes Gudsonn un norvégien surdoué en mathématiques, tous rassemblés par Daniel W. Stoddard, pape de la dynamique des systèmes, comme Jay Forrester dans la vraie vie.
On perçoit très vite les correspondances fiction-réel, car l’écriture reste très mesurée et ne déforme pas la réalité, elle la met en scène avec réserve et elle la prolonge avec la même approche, donnant aux éléments de fiction des airs d’authenticité. Ainsi de la découverte du comportement du modèle :
Mildred avait découvert le schéma n° 8, dit “ business as usual ”, et sa courbe en forme de cloche qui n’augurait rien de bon. Ce schéma décrivait ce qui se passerait si la croissance industrielle et démographique suivait son cours, sans que l’on fasse rien pour la juguler. Symbolisés par des courbes en traits pleins, les indices de l’abondance (consommation alimentaire par terrien, production industrielle, espérance de vie, etc.) dépassaient la capacité de charge de la planète vers 2020, indiquée par une courbe en pointillé. Puis ils chutaient brutalement, en 2050. […] — C’est la chose la plus effrayante que j’ai vue de ma vie, avait dit Mildred. → [CA] p. 33
Ainsi encore de la prise de conscience d’une croissance exponentielle. C’est Stoddard, le père de la modélisation, qui parle :
Un roi des Indes s’ennuyait Il promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une bonne distraction. Lorsque Sissa lui présenta le jeu d’échecs, le souverain demanda au sage ce que celui-ci souhaitait en échange de ce jeu extraordinaire. Alors Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l’échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Le prince accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste. Atterré, son conseiller lui expliqua qu’il venait de signer la mort du royaume : des siècles de récolte ne suffiraient pas à s’acquitter du prix du jeu.
— Dix-huit milliards de milliards de grains, murmura le Norvégien qui avait calculé, de tête. → [CA] p. 37-38
On suit les débats des quatre chercheurs et de leur mentor, leurs désaccords, leurs surprises devant les résultats de leur propre recherche. Et surtout comment le livre qu’ils publient fait déflagration, comment les économistes le rejettent, et comment la sorte de naïveté et de bon droit du scientifique se heurte à l’étal morne de tout ce qui paralyse notre monde. Les Dundee parcourent la planète pour promouvoir leur livre et faire prendre conscience. Ils sont propulsés à la crête des médias dont les mouvements à hue et à dia annihilent les contenus qu’ils proposent. Le livre détaille cette histoire du couple, qui met à jour le rapport vingt ans après sa première parution, mais sans horizon, et va finir par se retirer dans une ferme de l’Utah, pour élever des porcs. “ Ils ont cessé d’y croire, tout simplement ” → p.124. Eugene Dundee meurt en 20076.
Puis vient l’histoire de Paul Quérillot le Français. Il n’adhère aux conclusions du rapport que du bout des lèvres et se préoccupe d’abord de son intérêt et de sa place. À sa compagne d’alors il affirme :
— Tu sais, Patty, il est probable que nous ne connaîtrons pas l’effondrement de notre vivant. Les projections les plus pessimistes du rapport tablent sur un effondrement au milieu du XXIe siècle. Donc vraiment, il n’y a pas de quoi se rendre malheureux. → [CA] p. 131
Il fréquente les hippies, parcourt la Californie, profite de ses droits d’auteur du rapport, et s’en va sur les conseils de son père comme cadre richement payé à Elf Aquitaine, le grand pétrolier français, qu’il va nourrir de dynamique des systèmes. Avant de créer sa propre entreprise Systems. Et vivre les riches heures parisiennes, entre le champagne et ses amants, tout en gardant le vernis respectable qui sied à son statut.
“ Tu ne renies rien, avait dit Noémie [son épouse]. Mon oncle est un type bien, et je crois qu’il a raison. C’est bien joli de se préoccuper de l’avenir du monde, mais il ne faut pas oublier le tien. Le nôtre. ” → [CA] p. 175
Commence à se dessiner dans le récit les refuges de ces protagonistes de l’Apocalypse, ont cru certains, dont les années qui passent sont loin d’être à la hauteur de leur travail de recherche. Le monde et son chaos sociétal les taraudent et sapent leur confiance. Abel Quentin fait vivre tout cela avec vivacité et détails. Chacun se bâtit sa cabane, chacun se forge un abri, moral tout autant que physique. La littérature déroule l’implacable.
Surgit alors dans le roman un nouveau personnage, Rudy, journaliste un peu précaire, un peu porté sur l’alcool, à qui on [l’actionnaire du journal] demande un reportage sur ces chercheurs du rapport 21 : “ Ça avait fait pas mal de bruit, et puis les gens sont passés à autre chose ” → p. 227. Rudy lit le rapport :
Le premier, il avait démontré scientifiquement l’impasse de la croissance dans un monde fini. Il avait été violemment critiqué, aussi. Il était effarant de lire un livre vieux de cinquante ans qui disait tout. → [CA] p.235
Il se met à la recherche des acteurs, des éditeurs, et notamment il enquête sur le quatrième chercheur, le Norvégien Johannes Gudsonn, dont on a perdu ou presque la trace. Avec patience, le journaliste retrouve son parcours, sa passion pour les mathématiques, radicale comme peut l’être une croyance religieuse enclose en elle-même, sa dérive mystique, sa solitude revendiquée dans une cabane d’une île norvégienne, puis dans le Massif Central. Et là, l’écriture se perd dans les méandres des multiples délires et terreurs d’aujourd’hui, ceux et celles du Norvégien dont il retrouve les carnets :
Berkeley, le 15 mai 1974
Je ne vois plus que les famines, les pénuries, les monstruosités que préparent nos orgies présentes. San Francisco, où je me suis aventuré hier, me débecte : l’atmosphère paresseuse de la fête est partout, les gens boivent et rotent, l’air ahuri, satisfaits. → [CA] p. 344
Et plus avant, dans un manuscrit intitulé Soldat de l’invisible :
Un jour, Erika [une de ses compagnes] m’a dit qu’il fallait frapper le système en plein cœur. Elle parlait de charges explosives, de sabotage des trains, de fusils automatiques. Elle me parlait de faire sauter la banque centrale d’Oslo, ou la raffinerie de la Statoil. Je lui ai répondu : “ À quoi sert de détruire les Machines, si nous laissons les hommes pour les reconstruire ? ” → [CA] p. 457
Et le roman d’aujourd’hui fournit une vue saisissante, dans son imprécision même et son foisonnement, de la vague multiforme en train de nous submerger, sans boussole aucune, multipliée dans ses fausses informations mortifères, où la haine et la guerre s’affranchissent allégrement du droit, de la raison et de la science. La cabane, les multiples cabanes étriquées plutôt, peuvent-elles nous protéger de quoi que ce soit ?
1 Halte à la croissance ?, enquête sur le Club de Rome, par Janine Delaunay, et Rapport sur les limites de la croissance, par Donella et Dennis Meadows, Jorgens Randers et Wiliam W. Behrens III, Fayard, 1972. [HC?]
2 https://jancovici.com/recension-de-lectures/societes/rapport-du-club-de-rome-the-limits-of-growth-1972/
3 https://reporterre.net/Dennis-Meadows-Il-y-a-deux-manieres-d-etre-heureux-avoir-plus-ou-vouloir-moins
4 https://www.youtube.com/watch?v=lxFQ1a52tmQ
5 Cabane, Abel Quentin, Éditions de l’Observatoire, 2024. [CA]
6 Dennis Meadows est en fait toujours vivant en 2024.
Écriture le 16/10/24